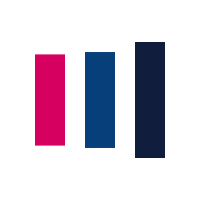Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
- Perceuses, visseuses et perfo-burineur
- Agrafeuses et cloueuses
- Scies et tronçonneuses
- Meuleuses, ponceuses et décapeurs
- Malaxeurs
- Défonceuses et raboteuses
- Outillage de soudure et gaz
- Nettoyage et aspiration
- Batteries, piles et chargeurs
- Entretien du jardin
- Consommables outillages portatifs
- Appareils de mesure, détecteurs
- Nettoyeurs haute pression
- Visserie, boulons et écrous
- Chevilles
- Pointes, clous et chevillettes
- Serrures cremones et accessoires
- Garnitures et ensemble de porte
- Ferrures menuiseries extérieures
- Equipements de portes
- Accessoires fermetures portes, portails et volets
- Fermetures et verrous
- Assemblage connexions bois fixations
- Grilles trappes hublots
- Boites aux lettres
- Coffres forts
- Seuils et profils
- Tubes et raccords PVC
- Tubes et raccords béton
- Tubes et raccords polyéthylène
- Tubes et raccords grès
- Tabourets et avaloirs
- Piquage, obturateurs et clapets
- Têtes de pont et têtes de sécurité
- Drainage agricole et routier
- Tubes et raccords polypropylène
- Tubes et raccords fonte
- Tubes et raccords polyester
- Stockage eaux pluviales
Tout savoir sur les cloisons intérieures : guide complet pour bien choisir et installer
Que ce soit pour aménager des espaces ou pour séparer des pièces, les cloisons intérieures sont des éléments indispensables dans les domaines de la construction et de la rénovation. Elles participent également à l’isolation thermique et phonique des bâtiments ou peuvent répondre à des caractéristiques spécifiques selon la nature du projet (cloison hydrofuge, cloison séparative, etc.).
Quelle différence entre une cloison sèche et humide ? Comment faire une cloison intérieure et quels matériaux choisir selon vos besoins ?
VM Matériaux répond à ces questions et vous conseille pour tous vos travaux d’aménagements intérieurs !
Les fonctions essentielles des cloisons intérieures
À l’inverse d’un mur porteur, la cloison intérieure n’est pas structurelle. Son rôle est d’assurer différentes fonctions comme :
-
Délimiter des espaces et les agencements intérieurs
-
Créer des pièces tout en assurant la distribution entre chacune
-
Contribuer à l’amélioration de l’isolation thermique et acoustique
-
Protéger contre l’humidité ou contre le feu dans certains cas (cloison coupe-feu)
Définition et rôle dans l’agencement des espaces
Les cloisons intérieures sont des parois non porteuses, utilisées pour créer des volumes et compartimenter les espaces. Elles jouent également un rôle esthétique et fonctionnel selon le type de cloison :
-
Cloison distributive : pour la circulation entre les pièces
-
Cloison séparative : pour séparer et isoler entre deux logements
-
Cloison décorative : pour le confort ou l’intimité des usagers

Isolation phonique, thermique et protection contre l’humidité
Au-delà de leur fonction de séparation, les cloisons permettent également de réduire les nuisances sonores et d’améliorer l’isolation thermique entre les pièces.
Dans les pièces humides comme la cuisine ou la salle de bain, la cloison contient les éventuelles projections d’eau. Son revêtement devra dans ce cas, être résistant à l’humidité.
Les principaux types de cloisons : sec ou humide ?
Les cloisons sèches et les cloisons humides se différencient par leur mise en œuvre.
La cloison sèche est réalisée avec des matériaux ne nécessitant pas d’eau ni de liant pour son montage. La cloison humide est quant à elle faite d’éléments collés entre eux à l’aide d’un liant comme du mortier ou de la colle.
Les cloisons sèches : légères et rapides à installer
Montées mécaniquement (par vissage), les cloisons intérieures dites « sèches » sont plus faciles et rapides à mettre en œuvre. Elles sont également plus légères et souvent plus fines que les cloisons humides.
Exemples de cloisons sèches :
-
Cloison en placoplâtre
-
Cloison alvéolaire (Placopan)
-
Cloison intérieure en bois
Les cloisons humides : solidité et durabilité accrue
Les cloisons humides sont fabriquées à partir de matériaux plus robustes et durables que les autres types de cloisons. Elles sont principalement posées dans les endroits exigeant une grande résistance à l’humidité, aux chocs ou encore au feu.
Exemples de cloisons humides :
-
Cloison intérieure en brique
-
Cloison en béton cellulaire
-
Cloison en pavés de verre
-
Cloison en carreaux de plâtre

Choisir sa cloison intérieure selon ses besoins spécifiques
Souhaitez-vous créer une cloison phonique, vitrée ou résistante à l’humidité ? Pour savoir quel est le meilleur type de cloison, il est important de faire le point sur vos priorités et vos besoins. Cela vous permettra de choisir des matériaux adaptés qui répondront aux exigences et aux contraintes de votre projet.
Isolation sonore : cloisons pour le calme et la tranquillité
Qu’il s’agisse d’un bureau ou d’une chambre, les cloisons acoustiques permettent de vous isoler efficacement contre le bruit afin de travailler ou de vous reposer paisiblement.
Une cloison intérieure phonique intègre généralement un isolant. Par exemple, une cloison en plaque de plâtre complétée par de la laine de roche offre une excellente isolation sonore entre deux pièces.
Pièces humides : matériaux résistants à l’humidité
Dans les salles de bain et les cuisines, les cloisons doivent impérativement résister à l'humidité. L’utilisation de matériaux hydrofuges est alors indispensable.
Si le placo BA13 hydrofuge s’avère suffisant pour créer des cloisons légères et peu exposées, le béton cellulaire et le carreau plâtre sont de bonnes alternatives pour réaliser des cloisons plus résistantes à l’eau.
Les matériaux les plus courants pour les cloisons intérieures
Les briques de terre cuite et les carreaux plâtre sont des matériaux fréquemment utilisés pour construire une cloison. Bien qu’ils offrent certains avantages en termes de résistance et d’isolation, la brique et le carreau de plâtre sont en revanche plus lourds et techniques à mettre en œuvre.
Pour cloisonner un espace ou pour créer un aménagement intérieur plus facilement, les matériaux les plus souvent préconisés sont les plaques de plâtre et le béton cellulaire (siporex).
Le placo-plâtre : polyvalence et facilité de pose
Omniprésentes en construction et pour les travaux de rénovation, les plaques de placoplâtre sont polyvalentes et simples à poser. Une cloison en placo est composée d’une ossature métallique (rail et montant), de deux parements en plâtre et d’un isolant intégré dans l’épaisseur de la cloison.
Pour répondre à de nombreux besoins spécifiques, différents types de plaques sont disponibles (plaques hydrofuges, plaques acoustiques, etc.).

Le béton cellulaire : léger et naturellement isolant
Très léger et facile à travailler, le béton cellulaire est un matériau naturel et performant. Il est résistant à l’humidité, ininflammable et offre une bonne isolation, aussi bien thermique que phonique.
Le bloc de béton cellulaire est une excellente alternative au carreau de plâtre pour les pièces humides ou pour créer une cloison de séparation acoustique.
Quelle cloison pour quel usage ? Conseils par pièce et besoin
Chaque pièce de la maison répond à des besoins précis. L’isolation acoustique sera privilégiée pour le calme d’une chambre ou d’un bureau. En revanche, la luminosité recherchée et donc le type de cloison intérieure ne sera pas le même pour ces deux pièces.
Le choix des matériaux pour monter une cloison dépendra également de l’esthétique et de la finition souhaitée.
La cloison pour une chambre : calme et intimité
La chambre est un endroit propice au repos, au sommeil et au bien-être.
Pour créer une atmosphère calme et cosy, privilégiez des cloisons en placo bien isolées et dotées d’un bon affaiblissement acoustique. Pour encore plus de confort, nous vous conseillons d’utiliser des isolants naturels (ouate de cellulose, laine coton, etc.) et des plaques de plâtre anti-COV (composé organique volatil). Cette combinaison assurera de bonnes performances et permettra également d’assainir l’air de la pièce.
Cloison pour un bureau : performance acoustique et lumière
Dans un bureau, une bonne isolation sonore est essentielle pour se concentrer et travailler efficacement. Comme pour la chambre, la cloison placo répond à cette exigence, mais ne permet pas de laisser passer la lumière naturelle.
Si votre priorité est de préserver la luminosité de la pièce, optez pour une cloison vitrée, une verrière ou une cloison fixe intégrant des briques de verre.
Pour cloisonner un bureau en open space et adapter les volumes selon vos besoins, privilégiez des cloisons intérieures modulables (cloison coulissante, cloison amovible, cloison en bois modulaire, etc.)

Épaisseur et structure : critères techniques à considérer
Quelle est l'épaisseur d'une cloison intérieure ? Pour pouvoir répondre à cette question précisément, il est primordial de prendre en compte les contraintes techniques de la cloison, ainsi que les performances attendues.
L’épaisseur de la cloison dépend essentiellement :
-
Du type cloison (cloisons séparatives ou distributives)
-
Du choix des matériaux
-
De la résistance mécanique, à l’humidité ou au feu exigée
-
De la nécessité à intégrer des éléments dans la cloison (gaines électriques, isolation, etc.)
-
Des performances thermiques et phoniques souhaitées
Épaisseur idéale selon les performances attendues
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, l’épaisseur des cloisons est très variable :
Épaisseur d’une cloison de distribution :
50 mm pour une cloison alvéolaire et 72mm pour une cloison standard en placoplâtre.
Épaisseur d’une cloison séparative :
Comprise entre 100 et 200 mm selon la technique utilisée et le matériau choisi (cloison SAD en placo, cloison séparative en béton cellulaire ou en brique).
Épaisseur d’une cloison en fonction des matériaux :
-
Plaque de plâtre : de 50 à 160 mm
-
Brique de cloison : de 30 à 50 mm (jusqu’à 200 mm pour une cloison séparative)
-
Carreaux de plâtre : de 50 à 100 mm
-
Béton cellulaire : de 50 à 200 mm (jusqu’à 500 mm pour des murs porteurs)
N.B. L’épaisseur nécessaire pour répondre aux critères de résistance dépendra principalement du type de matériau.
Épaisseur d’une cloison avec intégration d’éléments :
De 72 à 160 mm en moyenne pour une cloison en plaques de plâtre selon la largeur de la structure métallique et de l’épaisseur de l’isolant.
Épaisseur d’une cloison phonique et thermique :
De 70 à 150 mm selon le matériau utilisé, l’affaiblissement acoustique et la résistance thermique souhaités.
L’épaisseur de la cloison doit donc être adaptée aux contraintes spécifiques du projet tout en tenant compte de l’optimisation de l’espace et des performances techniques.
Un conseiller VM Matériaux pourra vous aider à faire le point afin de choisir une cloison intérieure correspondant à vos besoins !